« Oui Pub » ou l’art d’une lapalissade
Deux ans d’expérimentation, 14 territoires mobilisés, et une conclusion limpide : moins de publicités dans les boîtes aux lettres, c’est moins de déchets. Pendant que l’État et les collectivités s’appliquent à tester, débattre et temporiser, les budgets publicitaires, eux, prennent le large...
Depuis mai 2022, 14 territoires pilotes testent un nouveau modèle de distribution publicitaire : Oui Pub. Les prospectus non adressés (sans mention de l’adresse du destinataire) sont uniquement distribués dans les boîtes aux lettres affichant un autocollant « Oui Pub ». Initiée par la loi Climat et Résilience, cette expérimentation vise à réduire le gaspillage de papier et à interroger l’avenir de la publicité imprimée.
Deux ans après son lancement, le gouvernement a livré son premier bilan (Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Oui pub », octobre 2024). Verdict : la mesure fonctionne, mais ses effets collatéraux inquiètent.
Si les chiffres sont sans appel dans les territoires concernés – seuls ceux favorables à l’expérimentation y ont participé –, les déchets papiers ont chuté de 48 % en moyenne. Certaines collectivités enregistrent même une baisse de 70 % du volume de papier collecté.
Pourtant la France possède déjà un taux de recyclage du papier très élevé. Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), environ 62 % du papier graphique est recyclé, un chiffre qui atteint même 88 % pour les emballages en papier et carton. Ainsi, la production de déchets liés aux prospectus était déjà en grande partie maîtrisée par des circuits de recyclage efficaces.
Ce recul s’inscrit dans une tendance plus large : au niveau national, la distribution d’imprimés publicitaires sans adresse (IPSA) a fondu de moitié en dix ans, passant de 900 000 tonnes en 2013 à 400 000 tonnes en 2023. La crise du Covid-19 et la hausse des coûts du papier avaient déjà ébranlé le modèle du prospectus. « Oui Pub » semble avoir accéléré le mouvement.
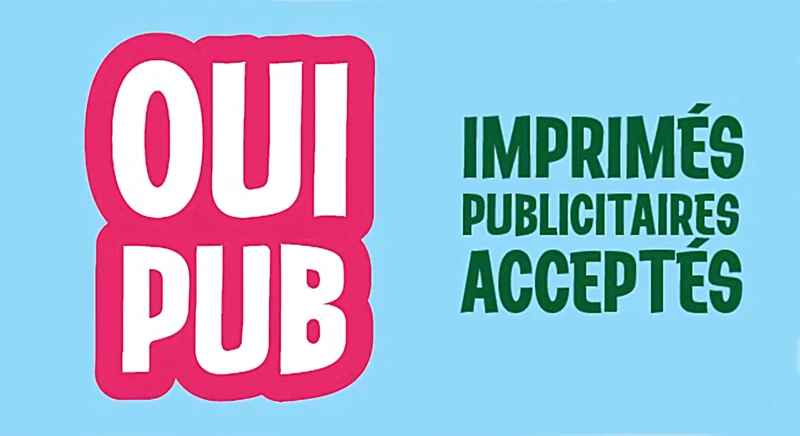
L’apposition de l’autocollant « Oui Pub » a été très variable selon les territoires, avec des taux d’apposition compris entre 0,33 % et 18,42 %, confie laconiquement le rapport. Si l’objectif environnemental est atteint, le « Oui Pub » peine encore à s’imposer dans les habitudes. Selon le rapport, seuls 6,98 % des habitants ont apposé l’autocollant sur leur boîte aux lettres. Un taux qui varie fortement selon les territoires : de 0,33 % à Bordeaux à 18,42 % à Dunkerque.
Les raisons ? Un manque d’information. 51 % des habitants ignorent que leur commune participe à l’expérimentation. Pourtant, ceux qui connaissent le dispositif y sont plutôt favorables : 63 % des personnes interrogées souhaitent son extension à l’ensemble du territoire, contre seulement 6 % d’opposants déclarés.
Les entreprises spécialisées dans la distribution de prospectus sont les plus touchées. Le groupe Milee (ex-Adrexo) a connu une chute vertigineuse de son activité, entraînant des licenciements massifs et sa liquidation judiciaire. Certaines PME locales, dépendantes de ce marché, ont purement et simplement cessé leur activité.
Même les grandes imprimeries souffrent. « Le prospectus représentait 33 % de l’activité de certaines imprimeries », souligne le rapport. Pour les papetiers, l’enjeu est encore plus critique. En 2024, il ne reste qu’une seule usine en France capable de produire du papier journal et de prospectus. Déjà contrainte à une reconversion partielle, elle craint de ne pas survivre à une interdiction définitive des IPSA.
Un basculement de budgets de communications vers les marketplaces américaines
Si les catalogues papier disparaissent, la publicité, elle, ne faiblit pas. Les annonceurs ont déjà pris les devants en misant sur le numérique. Catalogues en ligne, applications, SMS promotionnels : le budget autrefois alloué au papier se déplace vers d’autres canaux, principalement les géants du numérique comme Amazon, Google et Meta. Les « Big Three » dominent en moyenne 80 % du marché publicitaire digital en Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique, représentant 62 % du marché global sur ces territoires.
Non seulement le marché de la publicité ne faiblit pas, comme l’attestent les chiffres de l’observatoire de l’e-pub du Syndicat des régies internet qui précise qu’« en 2022, le marché français de la publicité digitale a atteint un sommet de 8,5 milliards d’euros de dépenses en croissance de +10 % par rapport à 2021 ».
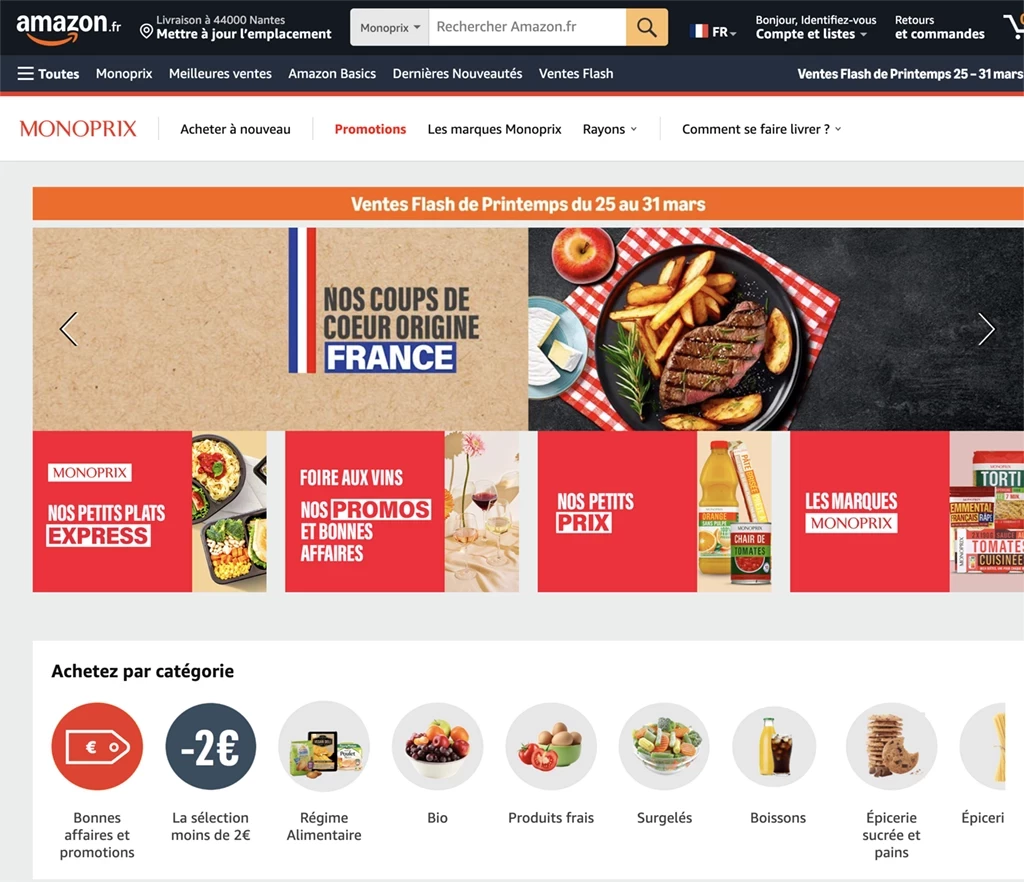
Ce basculement profite avant tout à ces grandes plateformes américaines, au détriment des entreprises françaises, déjà fragilisées par internet. Les distributeurs traditionnels, qui avaient su tirer profit du papier pour capter une clientèle locale, doivent désormais faire face à des coûts publicitaires numériques plus élevés et une dépendance accrue aux algorithmes des GAFAM.
Mais ce virage digital soulève une autre question : l’empreinte écologique de la publicité en ligne. « Moins de papier, c’est bien, mais plus de serveurs, c’est un problème », préviennent les experts. La publicité numérique génère une pollution invisible : consommation énergétique des data centers, émissions de CO₂ liées aux vidéos publicitaires, multiplication des e-mails commerciaux. Un impact environnemental que l’étude reconnaît, sans trancher sur la question.
Alors, faut-il généraliser « Oui Pub » à toute la France ? Les collectivités pilotes répondent oui à 89 %, convaincues des bénéfices environnementaux et des économies réalisées sur la gestion des déchets.
Cependant le gouvernement devra ménager les acteurs économiques pour éviter un séisme social. Plusieurs syndicats demandent un accompagnement à la transition pour les professionnels impactés.
Autre défi : réguler la publicité numérique pour éviter un simple transfert de pollution. Car si l’expérimentation « Oui Pub » a prouvé qu’il était possible de consommer moins de papier, elle rappelle aussi que « la publicité ne disparaît jamais vraiment, mais change simplement de forme ».
Et la « forme » est une campagne de marketing digital. Moins onéreuse pour les marques, cette stratégie les incite à multiplier ces campagnes tout en étant plus intrusives (collecte, utilisation d’informations personnelles, etc.) dans la vie privée des consommateurs.



